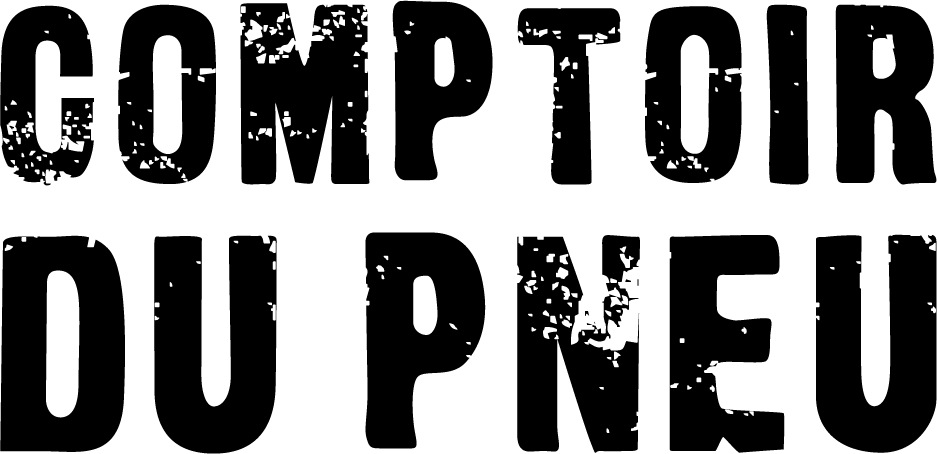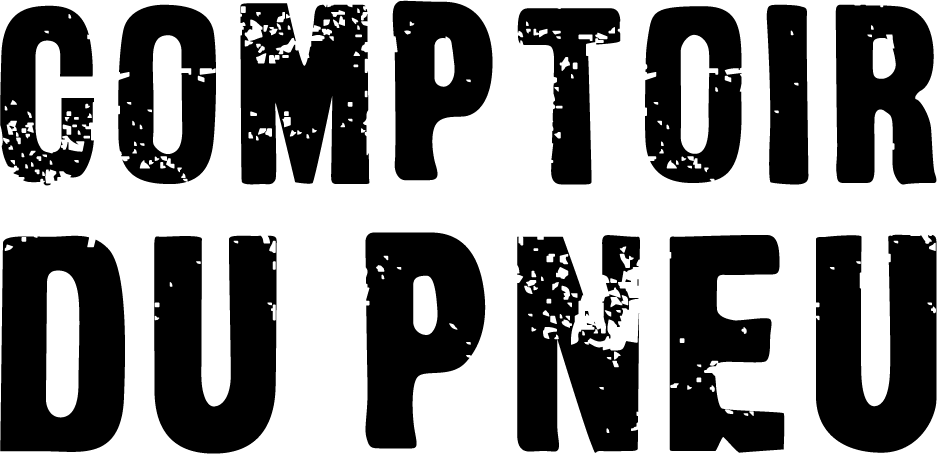« Freinages fantômes » : quand la voiture freine… sans qu’on freine
Une menace invisible sur la route
Sur l’autoroute, à 120 km/h, Joanna Peyrache voit son véhicule se mettre à freiner soudainement, sans qu’elle n’appuie sur la pédale. « La voiture était folle », racontera-t-elle plus tard. Ce type de scène, encore rare il y a quelques années, devient aujourd’hui un sujet de préoccupation pour les autorités comme pour les conducteurs : celui des « freinages fantômes ».
Le phénomène, qui désigne un ralentissement ou un arrêt soudain du véhicule sans intervention du conducteur, fait l’objet d’une enquête du ministère des Transports. En cause : la multiplication des systèmes d’assistance électronique et le risque de dysfonctionnement d’un équipement censé… sauver des vies.
Une technologie devenue indispensable… et parfois suspecte
Depuis 2022, tous les véhicules neufs vendus en Europe doivent être équipés d’un système d’assistance au freinage d’urgence automatique, dit AEB (Automatic Emergency Braking). Ce dispositif, pensé pour détecter un obstacle inattendu et freiner à la place du conducteur, a permis de réduire le nombre de collisions par l’arrière.
Mais le revers de la médaille commence à apparaître : certains conducteurs affirment que leur voiture freine sans raison apparente, parfois en pleine voie rapide. Dans ces cas, le système s’enclenche à tort, croyant percevoir un danger là où il n’y en a pas.
Les causes possibles sont multiples : capteurs mal calibrés, caméras brouillées par la pluie ou le soleil, radars perturbés après un remplacement de pare-brise, ou encore mise à jour logicielle défaillante. Certains automobilistes affirment même que le problème persiste après plusieurs passages en atelier, laissant planer un doute sur la fiabilité de ces technologies.
Entre flou technologique et scandale latent
Ce qui distingue les « freinages fantômes » d’un simple incident isolé, c’est leur caractère encore mal compris. Combien de cas ont été recensés ? Quels modèles sont concernés ? Les constructeurs se montrent prudents, invoquant le faible nombre d’incidents signalés au regard du parc automobile total.
Pourtant, plusieurs témoignages récents laissent craindre un problème plus structurel, lié à la dépendance croissante des véhicules à leurs logiciels embarqués. Certains experts évoquent un « risque systémique » : les mêmes algorithmes étant partagés entre différents modèles, un défaut pourrait potentiellement toucher des milliers de voitures.
Des associations d’usagers demandent déjà la création d’un registre national des incidents liés aux aides à la conduite et un contrôle indépendant des systèmes électroniques embarqués. Car pour les victimes, la peur est bien réelle : se retrouver à l’arrêt au milieu d’une voie rapide, sans raison visible, relève du cauchemar.
Quel danger pour l’automobiliste ?
Les conséquences d’un freinage fantôme peuvent être dramatiques. Sur autoroute, un arrêt brutal peut provoquer un carambolage ; en ville, il peut surprendre un deux-roues ou un piéton. À cela s’ajoute une difficulté juridique : qui est responsable en cas d’accident ? Le conducteur, censé rester maître de son véhicule ? Ou le constructeur, si le système est en cause ?
Les assureurs commencent eux aussi à s’inquiéter. Le développement de l’électronique embarquée brouille la frontière entre erreur humaine et défaillance technique. À terme, cela pourrait conduire à une refonte des contrats et à une nouvelle répartition des responsabilités entre conducteurs et fabricants.
Une régulation à marche forcée
Les pouvoirs publics tentent désormais de reprendre la main. Le ministère des Transports a demandé aux constructeurs de recenser les incidents et d’évaluer la fréquence des freinages intempestifs. En parallèle, certains parlementaires réclament davantage de transparence et la mise en place d’obligations de mise à jour régulière des systèmes de sécurité.
Cette régulation se heurte toutefois à une réalité : les véhicules modernes sont de véritables ordinateurs roulants. Chaque marque développe ses propres algorithmes, souvent protégés par le secret industriel. Sans accès aux données internes, il est difficile pour les autorités de déterminer si un freinage fantôme relève d’un bug isolé ou d’un défaut systémique.
Vers une meilleure information du conducteur
Face à ce constat, les spécialistes s’accordent sur un point : l’information du conducteur reste la première ligne de défense. Beaucoup ignorent que leur voiture peut décider de freiner seule. D’autres ne savent pas comment réagir lorsque cela se produit.
Certains experts recommandent qu’un signal sonore ou visuel indique systématiquement l’activation du freinage d’urgence, afin de permettre au conducteur de reprendre rapidement la main. D’autres suggèrent une meilleure formation à la conduite des véhicules équipés d’aides électroniques.
Un réflexe simple est souvent évoqué : en cas de freinage injustifié, appuyer franchement sur l’accélérateur peut désactiver le système et redonner la pleine maîtrise du véhicule. Encore faut-il savoir que cette option existe.
Un paradoxe des voitures modernes
Les « freinages fantômes » symbolisent les paradoxes de la voiture moderne : plus sûre, mais aussi plus imprévisible. En confiant une part croissante du contrôle à des systèmes électroniques, l’automobiliste gagne en sécurité… tout en perdant un peu de son autonomie.
Pour éviter que ce phénomène ne devienne le prochain scandale automobile, il faudra plus de transparence, de rigueur et d’éducation. Car au-delà des capteurs et des logiciels, c’est la confiance du conducteur qui est désormais en jeu.